Un hommage à l'étude et à la recherche
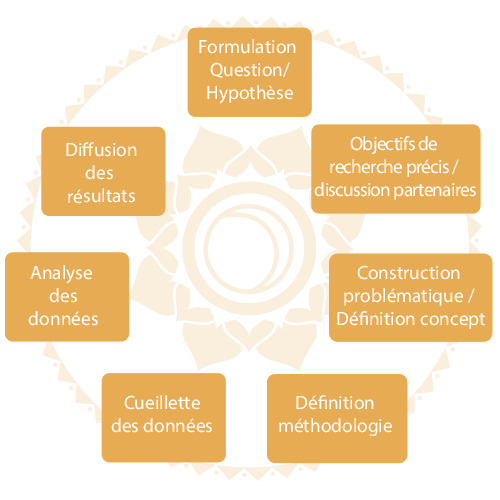
James D. Watson
Dernièrement, j'ai lu un livre sur La Double Hélice écrit par James Watson. Une des choses que j'ai aimé du livre c'est que l'éditeur a inséré des bonnes et des mauvaises réactions de ses collègues et même insérer des bonnes et des mauvais commentaires des gens faisant partie du milieux scientifiques. J'ai adoré la préface d'Etienne Baulieu. Il rend un hommage vibrant à l'étude des faits de la nature, à la recherche, à la curiosité scientifique? Plusieurs scientifiques vont chercher dans la biologie, la chimie ou même dans la physique qui est en somme une recherche sur la Nature et de ses Lois. Le hasard dans la Nature n'existe pas.
C'est une très belle hommage rendu à l'étude, à la recherche. J'ai adoré cette lecture et c'est tellement ça. Plusieurs diront que c'est plate d'étudier, de lire sur un sujet quelconque, etc. Après une lecture comme celui-là ils ne sauront plus quoi dire.
Qu'est-ce qui fait courir les scientifiques?
Le problème est d'importance, qualitativement et quantitativement. Quatre-vingt-dix
pour cent des scientifiques qui ont jamais vécu sont nos contemporains : les savants sont
une «espèce» en voie de développement. Dans le monde, il était mille en 1800, dit-on, et
un million en 1950. Tous les dix ans, leur nombre serait multiplié par deux! Il est urgent
de s'interroger sur les motivations des chercheurs, et c'est difficile car ils restent entre
eux, et ne font jamais part de leur disputes ni de leur joie véritables. La Double Hélice
banalise leur manière d'agir et donc les humanise, ce que je trouve très bien. Le livre de
Watson est un excellent croquis de la vie d'obsession qui est la nôtre. Il montre aussi, par
allusions, que les scientifiques souffrent de solitude. C'est le silence, sans feed-back du
public. Il y a les prix, les honneurs, mais on en connaît la valeur relative. De toute façon
ils ne permettent pas de comprendre l'activité réelle de la recherche. Personne, ou
presque, ne vient voir les dessins ou écouter la musique des chercheurs. Les
scientifiques vivent en général une vie matérielle bien «moyenne». Pourquoi ces
hommes à qui l'on reconnaît beaucoup de talent s'en contentent-ils? Alors, pourquoi?
Trois motivations principales tiennent les hommes de sciences. Ils veulent savoir plus, ils veulent gagner, et ils n'échappent pas à quelque ambition sociale. Ce tiercé, chacun l'assume avec son style - et Watson en a un, bien à lui, remarquable.
Savoir plus : je crois à l'extrême attrait de la curiosité, cette indomptable caractéristique des hommes qui, s'appliquant aux choses de la nature, les pousse sans rémission à chercher, à trouver. Quoi qu'on fasse, la curiosité scientifique restera dans le cœur et l'âme des hommes, peut-être pour leur malheur quand elle traitera de domaines comme les manipulations génétiques ou du fonctionnement cérébral. Mais quelle merveille de découvrir quelque chose de nouveau! Quelle sensation extraordinaire, un bonheur plein et gonflé comme une voile au bon vent. Soudain tout est plus simple que ce à quoi on a pensé lors d'hésitations torturantes et décourageantes. C'est alors un plaisir de chair et d'âme, fort, profond, comme la musique ou l'amour quelquefois, comme un grand paysage, ou un émotion chargée du destin qui nous dépasse, ce qu'on ressent aussi à Lascaux par exemple. Qui l'a éprouvé veut le ressentir encore, et cela suffi pour vouloir continuer.
Mais il faut gagner la course, et cela ne peut se faire dans l'angélisme, ni dans l'amateurisme. L'attitude qui permet la découverte, c'est l'esprit de compétition. Ceux qui se rapproche de nous sont quelquefois déçus en le constatant. Comment, la recherche ramenée au niveau d'un sport, ou d'un jeu? Réfléchissons: de quoi s'occupe-t-elle, sinon de trouver? Et ce que l'on trouve n'est-il pas «objectif» c'est-à-dire «public»? Cela veut dire qu'une fois la découverte faite, c'est fini; on peut broder autour, développer le sujet … en vain. Celui qui arrive second peut avoir donné les même efforts, ou plus, et déployé autant d'intelligence, ou plus, que le premier. Hélas, il a vraiment perdu, tout le monde le sait, tout le monde le lui dit, et il le ressent ainsi. Certes il est indispensable de confirmer et d'étendre les découvertes des autres, mais la «profession» de chercheur implique de trouver, c'est-à-dire d'arriver le premier. Telle est la définition même de la compétition, et nous avons non seulement le droit, mais le devoir d'être compétitif. Là réside notre professionnalisme. À la limite, ceux qui se vanteraient de ne pas vouloir gagner serait qualifié d'amateurs, ce qui est respectable et même souvent délicieux à vivre, mais ce qui est autre chose. Aimer les beautés de la nature n'oblige pas à les découvrir, pas plus que l'amateur de musique ou de peinture n'a besoin de composer ou de peindre pour être satisfait.
Gagner la course n'est, bien entendu, pas facile parce qu'il y a toujours plusieurs chercheurs intéressés par le même sujet et que chacun à sa manière contribue à la découverte qui ne sera pourtant attribuée qu'à un, deux ou trois hommes seulement. Dans le désir de gagner, en matière de recherche scientifique, entre cette volonté d'utiliser les autres et en même temps de s'en distinguer: le succès personnel est toujours aigu et ambigu à la fois! La complexité de cette règle du jeu est particulièrement captivante, y compris les frustrations qu'elle implique. De toute façon, une découverte à peine achevée devient elle-même un commencement, puisqu'il y a toujours de nouvelles questions. Rien n'est plus attrayant que ces interrogations perpétuelles.
Mais à la curiosité et à l'esprit de compétition s'ajoute une dimension sociale, que le public perçoit d'ailleurs peut-être plus que les scientifiques eux-mêmes. Par exemple, les chercheurs veulent-ils être «utile à la société»? Au fond, je n'en sais rien. Tout dépend des hommes et de leur domaine d'activité. La recherche biomédicale est évidemment la plus propice à cette vocation. Ou bien, les chercheurs sont-ils ambitieux socialement, au sens ordinaire du terme? Les conséquences sociales du succès scientifique ne sont pas négligeable: la renommé, les titres, les responsabilités, les voyages et les belles compagnies... Cependant, je l'ai déjà évoqué, malgré ces «récompenses», les scientifiques restent fragiles, anxieux, préférant se sous-estimer. Les décorations aident une certaine sérénité (chacun a ses faiblesses), mais servent plus à étayer une sécurité matérielle, nécessaire à la poursuite de cette carrière très difficile. Beaucoup d'orgueil et de masochisme se combine chez les scientifiques, y compris ceux qui réussissent.
(…..)
Une dernière remarque sur le «style» des ambitions de l'auteur de La Double Hélice. Il n'évoque n'a pas une seule fois l'utilité de son travail. Est-il évident que la recherche fondamentale contribue à améliorer le sort des hommes sur la terre, et qu'il n'est pas besoin d'en parler? Ou bien Watson est-il intéresser par le seul rébus, fasciné par son importance abstraite, seulement passionné par la lutte? En tout cas, la lecture de La Double Hélice oblige à se poser des questions sur les motivations des chercheurs? Que se passerait-il sans esprit de compétition? La science avancerait- elle au même pas si les découvertes n'étaient que le fait d'observations de hasard faites par des amateurs éclairés?
Étienne Baulieu, juin 1984
« La Double Hélice n'offre cependant pas un tableau typique de la vie des scientifiques, parce qu'elle omet de mentionner la contrainte très dure à laquelle la plupart des chercheurs sont soumis du fait de leur matériel expérimental. Un scientifique peut emmener une copine au cinéma, mais il y aurait beaucoup de chance qu'il doive lui dire: «Il faut que je retourne au labo vers 23 heures; j'en ai pour une heure et demie», parce ce qu'il doit s'occuper de quelque chose à un moment très précis. Durant cette heure et demie, il sera seul, à observer quelques faits bien concrets ou à réfléchir à un processus qu'il essaie de comprendre.»
Conrad H. Waddington